
Ana Lía Gabrieloni
Dans un bref essai intitulé «Musée», Georges Bataille (240) remarque la notoire insouciance des visiteurs dans les musées modernes, alors que les objets d’art composent à leurs yeux un miroir colossal où il est possible de se reconnaître dans ce que l’humanité contient d’admirable. L’observation est en partie juste mais en même temps, elle invite à ajouter quelques apostilles à propos du film sur l’art, et en particulier à propos du documentaire que ce travail va aborder : Civilización, film sur l’œuvre de l’artiste León Ferrari réalisé par Rubén Guzmán.[1] L’attitude de certains membres du public, lors de l’exposition rétrospective de l’œuvre de Léon Ferrari réalisée il y a quinze ans au Centre Culturel de la Recoleta (Buenos Aires, Argentina), est bien loin de l’abandon contemplatif que Bataille associe à ceux qui parcourent les salles des musées. L’attaque brutale d’une partie des œuvres, entreprise par un groupe appartenant à l’aile la plus conservatrice de l’Église catholique, s’est avérée un épisode digne d’être inclus au carrefour de l’histoire de l’iconoclastie et de l’histoire de l’art, toutes les deux partageant un fonds religieux que Ferrari abjura de manière catégorique tout au long de sa carrière.[2]
Dans le documentaire, on trouve du matériel d’archive qui témoigne de la destruction qui –selon les déclarations de l’artiste— finissent par compléter les œuvres exposées, dans la mesure où cette destruction a été la manifestation même de l’anéantissement provoqué par le dogmatisme que ces mêmes œuvres aspirent à saper. Bref, comme le déclarait le personnage du musicologue Reger qui se rend tous les deux jours au même salle du musée d’art de Vienne pendant trente-six ans dans le roman Alte Meister de Thomas Bernhard, abjurer l’iconoclastie religieuse équivaut à abjurer l’histoire de l’art occidental presque dans sa totalité. En conséquence, Civilización invite à réfléchir sur cette étrange forme d’iconoclastie propre à Ferrari, qui abjure des images à travers des images qui s’inscrivent dans la même histoire qu’elles contredisent mais sans l’anéantir.
C’est là que réside l’essence de l’imagerie de l’artiste, avec la certitude que «le problème ne commence pas avec l’histoire mais avec la mémoire», alors que «l’histoire [en ce sens] est l’héritière d’un problème qui se pose en quelque sorte en dessous d’elle, au plan de la mémoire et de l’oubli» (Ricœur 731). Cette formulation théorique de Paul Ricœur retrouve son expression poétique la plus achevée dans les vers bien connus de Victor Segalen (30), «Aux dix mille années», où on prend parti pour les irradiations imprévues du temps dans notre intérieur plutôt que pour leurs inscriptions figées dans les documents monuments de notre entourage: «La durée n'est point le sort du solide./ L’immuable n'habite pas vos murs, mais en vous».[3]
Ferrari matérialise ses idées en intervenant sur ce qui est sacré et intangible, c’est-à-dire à travers la profanation d’un musée qui n’a rien d’imaginaire. Il réunit en revanche l’iconographie canonique sur laquelle s’est construite la tradition occidentale et chrétienne depuis l’Antiquité. L’ironie critique se dégage ainsi de ses œuvres –selon les dits de Ponge (26) sur les Otages de Jean Fautrier— non comme un reproche mais comme une assez hautaine constatation. Constatation faite de silences et d’oublis complices conduisant à une restauration de cet ordre sous-jacent à l’histoire, qu’est la mémoire. Le documentaire collabore avec cette tâche restauratrice grâce à l’effet puissant de montage des images en mouvement qui intensifie la rhétorique critique à l’œuvre dans les images où Ferrari fixe le vertige de l’histoire. En effet, le montage –au sens technique et métaphorique du terme— [4] accorde à l’ensemble de l’œuvre et au documentaire ses conditions transcendantales d’existence: «la répétition et l’arrêt», qui sont en même temps, les conditions transcendantales de l’existence de la mémoire, comme le déclare Giorgio Agamben (69).
Parmi les œuvres de Ferrari où le montage visuel revêt la plus grande signification, nous devons souligner celle qui donne son nom au film, Civilisation occidental y cristiana (1965) qui consiste en une sculpture du Christ crucifié sur un bombardier américain semblable à ceux utilisés dans la guerre du Vietnam (fig. 1). Le rejet provoqué par cette œuvre, même dans des espaces d’avant-garde comme l’Institut Di Tella, a suscité une lettre où Ferrari (Katzenstein 289) écrit:
Notre civilisation atteint de nos jours le degré le plus raffiné de barbarie que l’histoire puisse enregistrer. (…) Le pays le plus riche et le plus puissant envahit un autre moins développé, torture ses habitants, photographie le torturé, publie les photos dans les journaux et personne ne dit rien. Hitler avait au moins le sens de la pudeur pour cacher ses tortures. (…) Nous voyons tous les jours les visages des torturés dans nos journaux, les mêmes journaux qui nous parlent de liberté, des droits de l’homme et qui n’ont même pas l’idée de reconnaître que l’un des droits fondamentaux de l’homme est celui de ne pas être torturé et que si quelqu’un connaît un cas de torture, et il n’y a rien de plus éloquent que la photographie du fait prise et publiée par le tortionnaire, doit au moins le condamner verbalement. (…) Ces photographies et la passivité des peuples occidentaux sont le symbole de notre barbarie avancée.[5]
La référence aux usages de la photographie, avec l’idée sous-entendue que les apparences s’y trouvent isolées dans un instant inconnexe qui ne susciterait que de l’indifférence chez l’observateur, évoque le film-essai Bilder der Welt und Inschrift des Krieges de Harun Farocki (1988).[6] L’horreur de la Shoah s’y inscrit d’une manière aussi inexorable qu’imperceptible sur la photo d’une usine vue du ciel, prise par les Américains une année avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale, afin d’identifier les cibles des attaques aériennes imminentes. Plusieurs années après, la CIA découvre sur cette photo ce que Hitler n’avait pas montré et que les Alliés n’avaient pas vu: près de l’usine, le camp de concentration d’Auschwitz.

Le documentaire de Guzmán intègre la résistance que Ferrari, ainsi que d’autres intellectuels et artistes, a manifestée contre la Guerre de Vietnam dans les années soixante et contre la dictature militaire en Argentine dans les années soixante-dix, intégrant ce que l’on pourrait appeler un «circuit informationnel». Ce mot clé est extrait du manifeste de l’œuvre collective, médiatique et multidisciplinaire Tucumán Arde [Tucuman Brûle], qui a eu lieu en novembre 1968 aux sièges de la Centrale Générale des Travailleurs argentins à Rosario et à Buenos Aires, et où Ferrari a participé en adhérant au programme de transformation politique proposé à partir de l’exposé de rapports, entretiens et documents sur la réalité sociale d’une des provinces les plus pauvres du nord de l’Argentine: Tucumán.[7]
Dans le film Civilización, l’ancien matériel d’archive alterne avec un autre plus récent, qui inclut le décernement du prix Nobel de la Paix à l’actuel président des États-Unis, ainsi que des références à un communiqué de l’ancien cardinal Bergoglio (actuel Pape François) qui condamnait comme une blasphème l’exposition rétrospective citée ci-dessus. Ferrari se demandait plusieurs fois comment les puissants passent sous silence la contestation de crimes contre l’humanité.[8] Ce silence pourrait être interprété, encore une fois avec les mots de Bataille (521-522), comme ce «vide inexorable» qui s’ouvre sous les pieds de ceux qui adoptent une vision manichéenne de l’humanité qui, en rigueur: «ne s’est donc pas fermé comme une vaste et lumineuse tombe de brume, car la variété infinie des apparences a disposé facilement les perspectives changeantes de l’espoir». Il ne s’agit pas ici de l’espoir téléologique de la religion qui se base sur la promesse de la rédemption mais de l’espoir dans la possibilité ontologique des hommes de choisir, étant donné que se vouloir moral et libre, tel que signalé par Simone de Beauvoir (31) dans l’essai Pour une morale de l’ambiguïté, est une seule et identique décision. Une décision indispensable pour résister au totalitarisme, au colonialisme et au dogme religieux.
Ferrari oppose à ce dernier, souvent combiné avec les deux autres, une sorte de nihilisme scatologique. Ce terme est employé ici dans sa double signification: d’un côté, la fin des temps, et de l’autre, les excréments, tous deux liés dans une installation où on pouvait voir une cage suspendue au-dessus d’une reproduction du Jugement dernier de Michel Ange, éclaboussée d’excréments d’oiseaux. Ce qui équivaut, selon l’artiste, à l’opinion de ceux-ci sur l’enfer [voir http://castagninomacro.org/page/obra/id/493/Ferrari%2C-Le%C3%B3n--/Jaula-con-aves]. On voit s’opposer au pacte pouvoir-autoritarisme-censure, la complicité entre l’artiste et le réalisateur de Civilización qui, dans cette occasion, répand les textures de l’abstraction sur l’écran où le genre documentaire traditionnel imposerait d’autres règles, basculant entre le didactisme et la propagande (fig. 2).
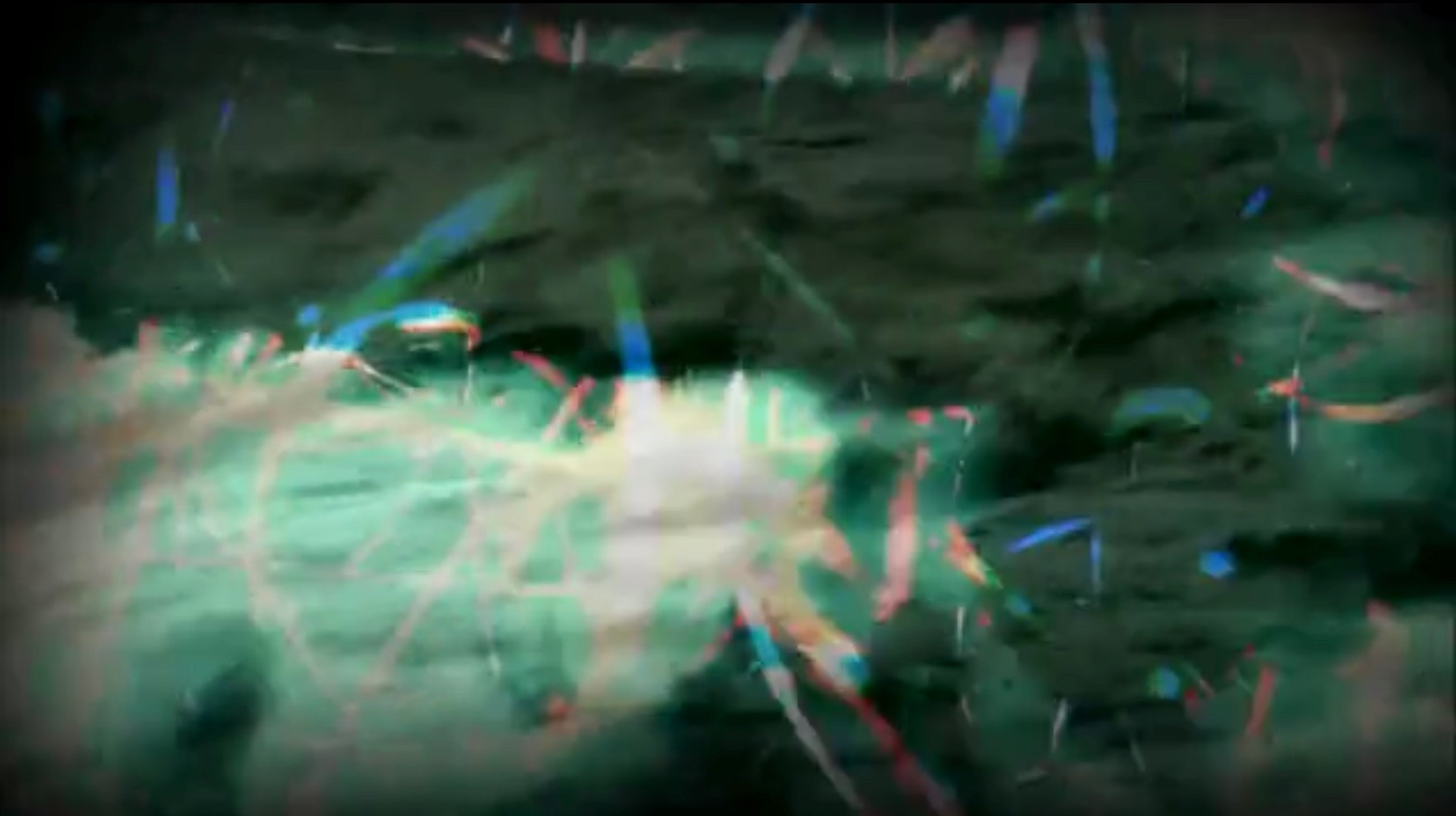
Justement, une des particularités de ce film —ainsi que des œuvres de Ferrari qui y sont exposées— c’est comment il réussit le dilemme posé par l’idéologie politique de l’art, entre les deux bouts de la fuite purement esthétique, comme dans l’art pour l’art, et le didactisme pamphlétaire, dans le style du réalisme socialiste. Nous tenons à réfléchir à ce dilemme par rapport au documentaire, où le traitement des images articule idéologie, politique et esthétique dans un discours narratif, selon la distinction due à John Berger (95), «introverti» car il aborde l’invisible et l’occulte, au lieu d’exposer et d’offrir ce qui est révélé. En outre, le circuit informationnel —le contexte de production et de réception incarné dans les images de Ferrari— s’ajoute dans le documentaire comme une ressource fonctionnelle à cette articulation, ce qu’on peut appeler paysages intégrateurs: manifestations exemplaires des révélations réciproques entre les images, les textes, les espaces, les évènements et les regards.
La nature, presque absente dans l’iconographie de Ferrari, apparaît ici avec l’intensité croissante d’une déflagration. Selon les termes de Guzmán:
Civilización commence avec un paisible écoulement d’eau qui augmente rapidement jusqu’à devenir un débit turbulent et violent confronté à une force puissante de sens opposé. Ce ensemble de séquences, traité plastiquement grâce aux recours du cinéma expérimental, n’est que la vieille technique du montage soviétique consistant à juxtaposer et coordonner deux séries d’images (thèse et antithèse), concrètes et symboliques dans ce cas-ci, destinées à produire sur le spectateur une synthèse des significations.[9]
Du montage de cette séquence surgit la géographie asymétrique que conforment l’oppression et la rébellion. Comme dans l’inoubliable début de la première partie de Le Fond de l’air est rouge de Chris Marker (Les Mains fragiles 1977-1988), il n’y a pas de place dans le monde –le monde tel qu’on le montre grâce au ce matériel d’archive récupéré— pour des conciliations entre l’instinct et la conscience des individus. À savoir, entre le vif désir qui nous pousse vers la liberté et la résignation avec laquelle nous acceptons les limites qui lui sont imposés. Vassili Grossman (199) pensait que de telles conciliations entraînent «Un espoir insensé, parfois vil, parfois lâche», qui favorise la soumission.[10] Celle-ci —identifiée par Malraux avec une certaine vocation de l’imagerie occidentale et chrétienne, qui est le matériel primaire de l’art de Ferrari— devient, au regard de l’écrivain russe, une mutation de la nature humaine jetée dans le chaudron de la violence totalitaire. D’où, pour Grossman, la réponse à la question si l’homme peut perdre le droit inhérent à sa liberté, contient le destin entier de l’humanité et des États totalitaires. Et il ajoute: «la lumière de notre temps, la lumière de l’avenir» dépend du fait que «L’homme ne renonce pas de son plein gré à la liberté.» (200).
Bref, voilà peut-être la réponse au dilemme que nous tentons d’élucider et qui concerne les interactions entre art et idéologie dans ce documentaire, lesquelles se voient renforcées par la liberté du geste inhérent à la création chez le réalisateur, qui nous emmène dans un musée où nous devenons des visiteurs non plus passifs et insouciants comme ceux cités au début de cette travail, mais actifs, voire perturbés.[11] Le musée documenté est une hypostase illuminée (à l’écran), critique et esthétique de l’œuvre de León Ferrari, où «chaque signe se fait annonciateur de quelque joie menacée» (Bataille 521). C’est dans la conscience de cette menace que réside la composante idéologique de cette œuvre filmographique; aussi bien que, dans l’expérience de la joie, sa filiation la plus désintéressée avec l’art. En fin de compte, l’univers de Ferrari dépeint dans le film est «gêné, gênant» —comme Ponge (15) écrivait sur les Otages de Fautrier— en transformant l’horreur humaine en «beauté».[12] Quelque chose comme un abaissement qui monte à l’égard de la pesanteur morale; une chute vers le haut.[13]
Grâce et pesanteur. Sensations ambigües comme celles causées, sous l’effet d’un transfert d’expérience, par un des plus beaux passages de Ossip Mandelstam (34) à propos de son voyage en Arménie, où l’extase provoquée par la vision d’un «impudent incendie» de pavots laisse la place à la gêne: «Éclatants jusqu’à la douleur chirurgicale, factices insignes de cotillon, grands, trop grands pour notre planète, papillons incombustibles à gueule mi-ouverte, ils poussaient sur de répugnantes tiges velues».

Notes
[1] Civilización, réalisé par R. Guzmán. Argentina, 2012, 56’. https://vimeo.com/72206814
[2] Lorsque Alain Besançon retrace l’histoire intellectuelle de l’iconoclasme, il met en relief les liens féconds entre les images divines et les images profanes qui constituent ce fonds. Par conséquent, il soutient que c’est dans le domaine artistique que sa recherche trouve ses points de départ et d’arrivée, même si son intention n’est pas de développer une histoire de l’art. Voir L’Image interdite: une histoire intellectuelle de l’iconoclasme. Paris: Fayard, 1994. Dans le cadre de réflexion d’André Malraux (118) sur l’art avant ce qu’il appelle la «métamorphose du monde en tableaux» dès la deuxième moitié du XIXe siècle, l’iconoclastie serait en effet contraire à cette transfiguration des images religieuses destinées à la soumission.
[3] Voir le concept du monument d’art —que, sans exception, est aussi un monument historique et à l’inverse— de l’historien viennois Alois Riegl, telle qu’il le développe dans son œuvre Der moderne Denkmalkultus: sein Wesen und seine Entstehung, publiée en Vienne en 1903. Il existe une version en français: Alois Riegl. Le Culte moderne des monuments. Paris: Seuil, 1984.
[4] Montage en tant que composition selon critères de sélection et combinaison de photogrammes, aussi bien que de fragments du passé, souvenirs.
[5] C’est nous qui traduisons.
[6] Voir John Berger et Jean Mohr, Another Way of Telling. New York: Pantheon Books, 1982, 89.
[7] Voir à ce sujet, Ana Longoni et Mariano Mestman. Del di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino. Buenos Aires: Eudeba, 2000. Pour une version du manifeste écrit par María Teresa Gramuglio y Nicolás Rosa, voir Inés Katzenstein (Éd.). op. cit., 2007, ainsi que Rafael Cipollini (Éd.). Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011. Il y a une version en anglais de ce manifeste, «Tucumán Burns», Alexander Alberro et Blake Stimson (Éd.). Conceptual Art: a Critical Anthology. Cambridge, Massachusetts, etc., the MIT Press: 1999.
[8] Cette inquiétude est à l’origine de Nosotros no sabíamos, œuvre basée sur en ensemble d’articles recueillis par Ferrari en 1976. Il s’agit de nouvelles publiées dans des journaux argentins et étrangers —comme La Nación et Le Monde, entre autres— sur les détentions et les disparitions pendant la première étape de la dictature militaire en Argentine.
[9] Extrait d’un entretien inédit avec Rubén Guzmán à l’occasion de l’avant-première du documentaire au BAFICI [Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente], 2012.
[10] Et il ajoute: «une soumission du même ordre, une soumission pitoyable, parfois vile, parfois lâche» (199).
[11] La dialectique entre art et idéologie, inhérente à l’oeuvre de Ferrari aussi bien qu’au documentaire de Guzmán où cette dernière est recrée, se traduirait par les idées de Grossman déjà évoquées dans le binôme beauté - liberté.
[12] Cette transformation serait de l’ordre du sublime, compris ici comme une sublimation créatrice de l’aísthesis, c’est à dire, une sublimation qui transforme notre rapport au sensible (Saint Girons 112-115).
[13] Ces expressions ainsi que celle au début du dernier fragment de ce travail sont extraites de l’essai «La Pesanteur et la grâce» du livre homonyme de Weil. Dans un autre essai («La Nécessité et l’obéissance»), Weil (12) réfléchit sur ce qu’elle appelle «action non agissante», que c’est ne pas une action, mais une sorte de passivité. Passivité en tant qu’elle va au delà de n’importe quel but immédiat pour devenir «non l’aspect de l’objet, mais de l’impulsion», à savoir un mouvement libéré de l’obligation —qui implique toujours une restriction de la liberté— quoique dépendant de la nécessité. Réflexion qui clarifie, à notre avis, les relations que les images fixes et en mouvement de Ferrari et Guzmán entretiennent à travers l’art, l’idéologie et la politique.
Bibliographie
- Agamben, Giorgio. Image et mémoire. Paris: Hoëbeke, 1998.
- Bataille, Georges. Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 1970.
- Berger, John y Jean Mohr. Another Way of Telling. New York: Pantheon, 1982.
- Berger, John. Bento’s Sketchbook. New York: Pantheon, 2011.
- Bernhard, Thomas. Maîtres anciens. Paris. Gallimard, 1991.
- Grossman, Vassili. Vie et destin. Lausanne: L’Age d’homme, 1980.
- Beauvoir, Simone de. Pour une morale de l’ambigüité.Paris: Gallimard, 1947.
- Katzenstein, Inés (Éd.). Escritos de vanguardia. Arte argentino de los años 60. New York, MOMA / Buenos Aires: Fundación Espigas & Fundación Proa, 2007.
- Malraux, André. Les Voix du silence. Paris: Gallimard, 1951.
- Mandelstam, Ossip. Voyage en Arménie Lausanne: L’Age d’homme, 1973.
- Ponge, Francis. L’Atelier contemporain. Paris: Gallimard, 1977.
- Ricœur, Paul. «L’Écriture de l’histoire et la représentation du passé». Annales. Histoire, Sciences Sociales. 4. (2000). 731-747.
- Riegl, Alois. Le Culte moderne des monuments. Paris: Seuil, 1984.
- Saint Girons, Baldine. Il Sublime. Bologna: Mulino, 2006.
- Segalen, Victor. Stèles. Paris: Crès, 1922.
- Weil, Simone. La Pesanteur et la grâce. Paris: Plon, 1947.
Referencia electrónica
Gabrieloni, Ana Lía. «De la civilisation. Le musée impossible». Hyperborea. Revista de ensayo y creación 2 (2019): 146-156. http://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/de-la-civilisation-le-musee-impossible-142







